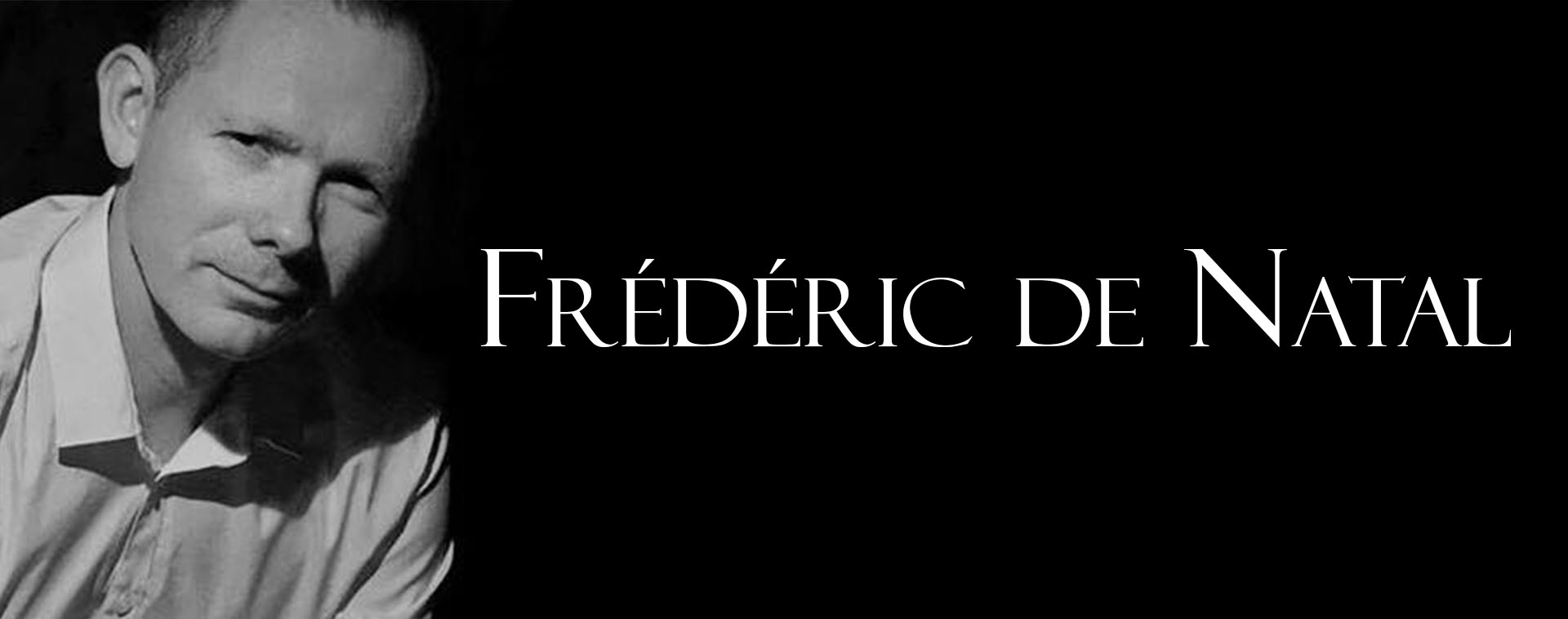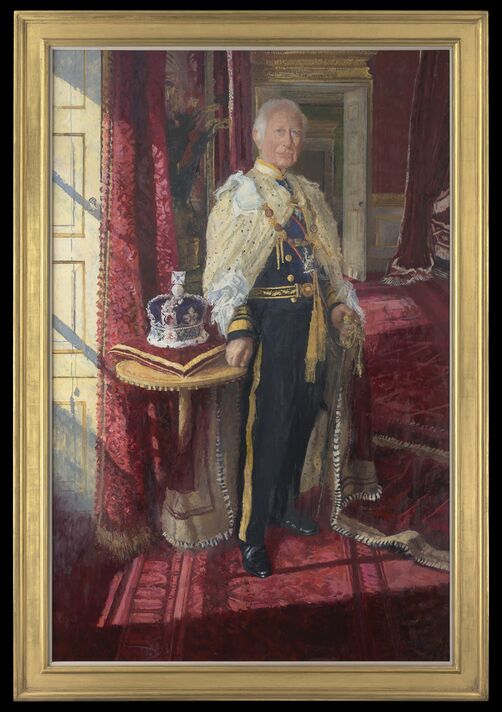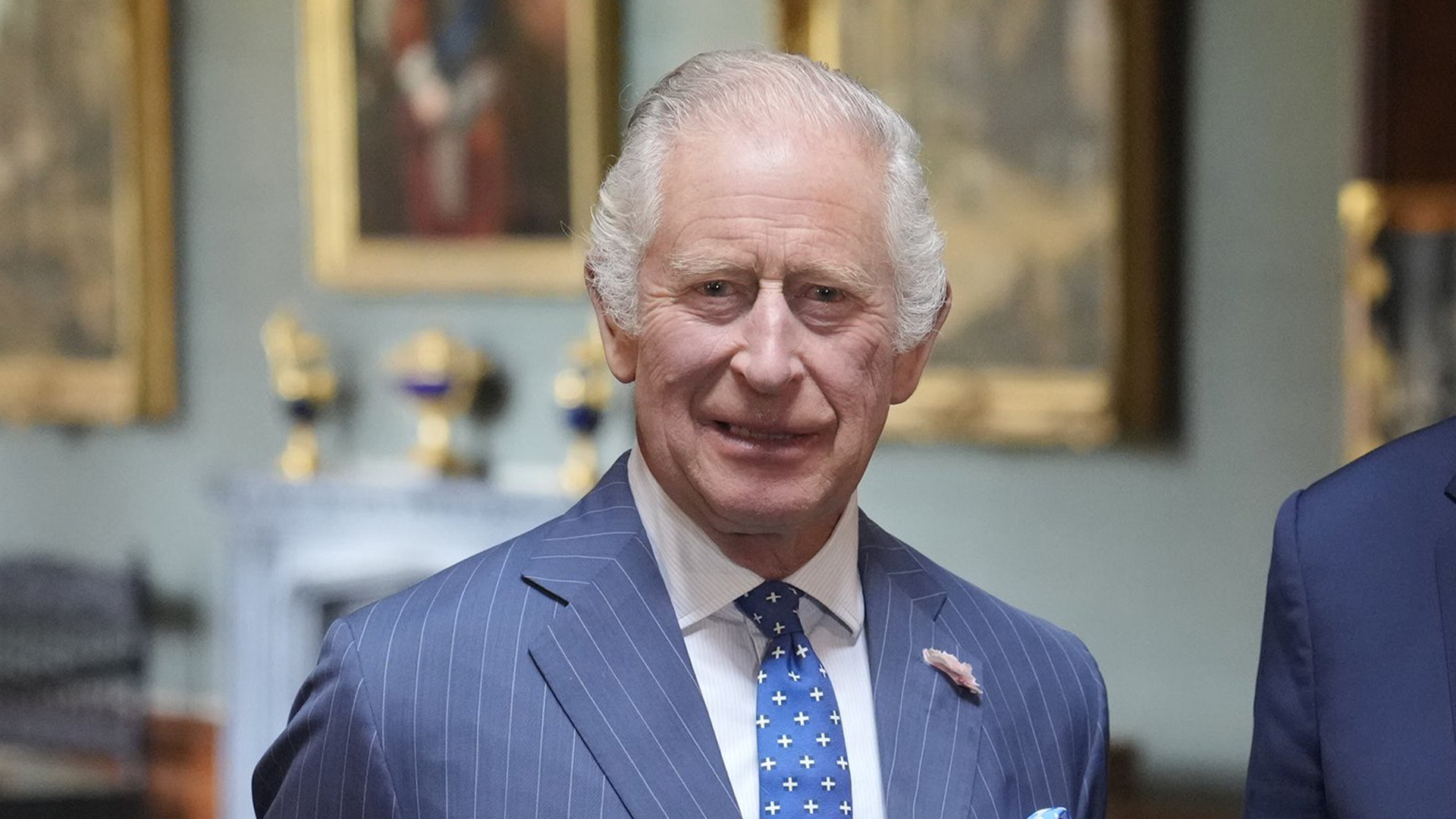Les Blackamoores, ces Africains qui ont vécu dans l’Angleterre des Tudor, ont laissé une empreinte indélébile sur la culture et l'histoire britanniques, une réalité souvent méconnue ou négligée dans les récits traditionnels.
Une polémique face à l’histoire

C’est une série en trois parties qui a suscité la controverse sur les réseaux sociaux et mis en émoi les historiens. Souhaitant traiter de la vie d’Anne Boleyn, la seconde épouse du roi Henri VIII au destin tragique, la très britannique Channel 5 a créé la surprise en confiant le rôle principal à l’Afro-Américaine Jodie Turner-Smith. Accusée de réécrire l’histoire avec des accents wokistes, la série a été très rapidement pointée du doigt par ses plus ardents détracteurs qui ont crié à l’hérésie et menacé de convoquer le ban et l’arrière-ban de l’inquisition virtuelle du net. Face à eux, les aficionados de l’actrice rappelant que la cour des Tudors, une dynastie marquante de la monarchie anglaise, avait été pourtant constellée d’Africains : les Blackamoores.
C’est en 2013 que le terme est apparu dans les librairies du Royaume-Uni. Basé sur une étude de 250 000 documents qui a contraint son auteur à une décennie de travail intense, l'historien et écrivain britannique Onyeka Nubia a publié une histoire inédite des Noirs dans l'Angleterre de l'ère Tudor afin de casser le mythe persistant qui veut « que les Africains de cette période occupaient automatiquement les positions les plus basses de la société [et étaient] généralement stigmatisés comme esclaves, immigrants de passage ou étrangers dangereux ». Une remise en cause de l’histoire officielle, visant également à briser la caricature qui affirme que la plupart des Britanniques noirs de l’ère Tudor étaient uniquement nés à l’étranger, en prouvant qu’une minorité importante était bel et bien née et avait grandi en Angleterre, jouant un rôle non négligeable dans l’histoire de la Renaissance.
Une présence africaine lointaine sur le sol anglais

S’il est évident que le choix de l’épouse de Will Smith pour incarner la reine Anne Boleyn relève d’un choix artistique personnel du producteur et du réalisateur, la vérité est plus nuancée que les fariboles publiées sur certains réseaux sociaux panafricains qui n’hésitent pas à travestir l’histoire à des fins idéologiques, flirtant parfois avec le complotisme historique. Le livre a eu un succès retentissant et a poussé la célèbre BBC à consacrer un documentaire en quatre volets sur l’histoire des Africains et l’Empire britannique, accréditant la thèse d’Onyeka Nubia. Brisant un stéréotype tenace selon lequel l’immigration africaine sur le sol de Sa Gracieuse Majesté ne daterait « QUE » de la fin de la Seconde Guerre mondiale, si l’on excepte les brefs passages d’esclaves capturés sur le continent africain pour les besoins du commerce triangulaire, en farfouillant un peu plus dans les bibliothèques, on peut même attester de la présence de soldats et civils romains, issus d’Afrique du Nord, au Royaume-Uni, basés près du mur d’Hadrien. La plus célèbre étant la « Ivory Bangle Lady », vivant à York au IVe siècle, enterrée avec ses bijoux et artefacts africains.
Être noir à l’époque Tudor

Sans devoir remonter à Jules César, qui sont donc ces « Black Tudors » et « Black Stuarts », ces fameux Africains qui furent les invisibles de la monarchie Tudor ? Majoritairement libres de leurs mouvements, ils étaient environ un peu plus de 200 répartis à travers tout le royaume. Parmi eux, on peut citer John Blanke, employé comme musicien à la cour, possiblement venu en Angleterre aux côtés de Catherine d’Aragon, future épouse d’Henri VIII. Sa présence est attestée par des documents d’époque qui évoquent sa participation aux funérailles du roi Henri VII et au couronnement de son successeur. Trompettiste royal, il sera grassement payé par le monarque, avec un salaire double de celui d’un ouvrier agricole et le triple de celui d’un simple domestique de l’époque. On cesse de suivre son parcours après 1512. Les historiens suggèrent qu’il a quitté la cour après avoir reçu un somptueux cadeau vestimentaire lors de son mariage. Toutefois, son souvenir a traversé les siècles puisqu’il est visible sur un manuscrit conservé à Westminster. Une autre figure, celle de Jacques Francis, qui fut un plongeur chevronné, employé pour aller récupérer les armes du roi Henri VIII présentes sur le « Mary Rose », un vaisseau coulé en 1545 après une bataille avec les Français à Portsmouth. Ici encore, son nom et son origine sont cités dans un document daté de 1548. Il sera même le témoin qui sauvera la vie de son employeur accusé de vols de matériaux dans d’autres épaves. Preuve en soi du respect témoigné par les Anglais de cette ère envers ces Blackamoores.
Une histoire Tudor écrite au féminin

Les femmes ne sont pas oubliées dans cette histoire anglo-africaine. L’histoire de Mary Fillis, arrivée en Angleterre vers 1580 où elle est employée comme servante auprès d’autres Africains chez un marchand nommé John Barker, illustre l’histoire de ces Africains sous l’ère Tudor. Il est probable qu’elle ait été d’origine marocaine au moment où les deux royaumes commencent à nouer des relations commerciales et militaires afin de faire front commun contre l’Espagne. Baptisée en 1597 de son propre chef, elle finira sa vie comme couturière, peut-être établie de manière indépendante. Mais celle qui retient encore plus l’attention de tous, reste la vie fascinante de l’Africaine Cattelena d'Almondsbury que l’on peut découvrir dans « Black Tudors : The Untold Story » (Les Tudors noirs : l'histoire non racontée). Interviewée par la BBC, son auteur, le professeur Miranda Kaufmann, nous raconte que Cattelena a passé la plus grande partie de sa vie « non loin de Bristol, jusqu'à sa mort en 1625 ». Elle rappelle qu’il reste d’ailleurs un inventaire exhaustif des biens qu’elle possédait : de la literie, des casseroles, un chandelier en étain, une bouteille en fer blanc, une douzaine de cuillères, des vêtements et un coffre. Mais « son bien le plus précieux était peut-être une vache, qui non seulement lui fournissait du lait et du beurre, mais lui permettait de tirer profit de la vente de ces produits à ses voisins ». Les biens de Cattelena, « de ses ustensiles de cuisine à sa nappe, dit le professeur Kaufmann, chacun nous raconte quelque chose de sa vie. Mais le fait qu'elle les ait eus en sa possession nous en dit encore plus : Les Africains en Angleterre n'étaient pas possédés par d'autres personnes, mais eux-mêmes possédaient des biens. Ce n'était pas dû à un sentiment moral supérieur, s'empresse-t-elle d'ajouter afin de balayer toute remise en cause par ses contradicteurs (assez virulents), mais simplement au fait que [l'Angleterre] n'avait pas encore de colonies propres pour fournir des marchés aux Africains asservis. » Cela viendra d’ailleurs par la suite, ouvrant un autre chapitre jugé plus controversé de l’histoire coloniale britannique que la couronne continue de payer.
Les Africains d’Ecosse

La cour d’Écosse a également eu ses Africains. Sous le règne du roi Jacques IV, plusieurs Noirs sont attestés à Édimbourg grâce à une comptabilité fournie, gardée précieusement. Deux femmes africaines furent les suivantes de la reine Margaret Tudor comme de la princesse Margaret Stuart. Le poète William Dunbar évoqua leur présence dans un poème qui a traversé les siècles, « Of an Blak-Moir », aux accents très érotiques. D’abord esclaves, vendus par des corsaires ou venus d’Espagne, ils ont progressivement obtenu leur liberté. C’est la reine Elizabeth Ire qui, s’agaçant de leur présence, décide de mettre fin à ce qui reste considéré comme la première migration importante d’Africains en Angleterre. Dans une lettre envoyée au Conseil privé en 1596, la souveraine impute en grande partie à la population africaine les problèmes sociaux persistants de l’Angleterre, écrivant que le pays n’avait pas besoin de « de ces Blackamoores apportés dans le royaume ». Cette proclamation a été envoyée aux maires des grandes villes d’Angleterre qui ont fini par interdire leur présence dans ce qui n’était pas réellement un enjeu selon Janice Liedl, professeur d’histoire à l’Université Laurentienne de Sudbury, en Ontario. Elizabeth Ire a ensuite fait en sorte qu'un marchand nommé Casper van Senden expulse les Africains d'Angleterre. Un projet qui avorta puisqu'un édit vint contrecarrer la volonté royale, lui rappelant que les Africains ne pouvaient être jetés hors du royaume sans l’accord de leurs « maîtres ». Ce que ces derniers se passèrent bien de faire.
« Beaucoup de Tudors noirs ne pourront jamais être connus », regrette toutefois le professeur Miranda Kaufmann. En effet, « seuls les greffiers les plus diligents avaient noté des détails tels que le lieu d'origine ou la couleur de la peau » ajoute-t-elle avec une pointe d'amertume. Véritables oubliés de la monarchie britannique, les Blackamoores sont désormais à nouveau inscrits dans le marbre blanc de l’Histoire.